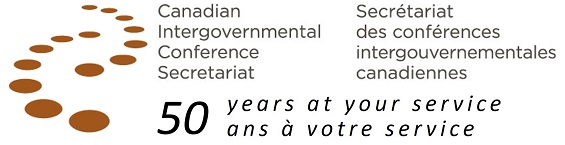
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)
DOCUMENT D’INFORMATION – RECOMMANDATIONS SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
FICHE D’INFORMATION
En octobre 2006, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) avait convenu d’explorer des solutions pour améliorer l’efficacité des évaluations environnementales (ÉE) au Canada. Puis, en septembre 2007, les ministres ont décidé d’étudier tout un éventail de questions associées à l’évaluation environnementale au Canada. Parmi ces questions, mentionnons l’inefficacité des procédures, le chevauchement des mandats et des responsabilités, le non‑respect des délais, le fait que les gouvernements se basent sur des critères différents pour exiger une ÉE et la nécessité de considérer les ÉE stratégiques régionales. Les travaux du CCME dans ce secteur visent le résultat suivant : Les décisions relatives aux évaluations environnementales des projets sont prises en temps utile, de façon prévisible et efficace, et assurent la sauvegarde de l’environnement.
Le Groupe de travail sur l’évaluation environnementale (GTÉE), formé pour cet exercice, a tenu des consultations publiques sur des recommandations provisoires concernant l’approche « un projet, une évaluation environnementale » et un projet de cadre et de méthode pour l’ÉE stratégique régionale.
Recommandations
1. Approches « un projet, une évaluation environnementale »
Le principal objectif d’une approche « un projet, une évaluation » est d’établir un seul processus d’ÉE, appliqué de façon uniforme, qui est dirigé ou réalisé par l’autorité la mieux placée et permet à chaque ordre de gouvernement de prendre ses décisions en temps voulu, de façon sûre et prévisible.. Pour réaliser une ÉE efficace, de haute qualité, qui favorise la prise de décisions respectueuses de l’environnement et le développement durable, un processus « un projet, une évaluation » doit respecter les délais, être prévisible pour tous les participants, être flexible pour s’adapter à un éventail de projets, assurer la participation du public au besoin, remplir l’obligation de consulter les peuples autochtones et définir clairement les responsabilités de chacun.
|
Recommandation concernant l’approche « un projet, une évaluation » : Pour établir une approche « un projet, une évaluation » qui n’entraîne aucun transfert de pouvoir décisionnel entre les autorités compétentes, il est recommandé ce qui suit :
|
2. Évaluation environnementale stratégique régionale
L’évaluation environnementale stratégique régionale (ÉES-R) est un processus visant à évaluer systématiquement les effets environnementaux potentiels, y compris les effets cumulatifs, d’une diversité de politiques, de plans ou de programmes stratégiques ciblant une zone géographique ou une région donnée. Le CCME s’est efforcé de faire progresser la science et la pratique de l’ÉES-R en développant une vision pancanadienne de l’ÉES-R, qui fait état des différents modèles d’ÉES-R et des avantages de ces modèles pour les Canadiens.
|
Recommandation concernant l’évaluation environnementale stratégique régionale : 1. Le CCME a la possibilité de faire preuve de leadership en gestion de l’environnement au Canada et partout dans le monde en mettant de l’avant de nouveaux cadres et des approches novatrices qui favorisent le développement durable. S’il étend sa pratique de l’évaluation environnementale à l’ÉES-R lorsque les circonstances s’y prêtent, le Canada deviendra un chef de file mondial à ce chapitre. Pour réussir, il faut cibler un plus grand éventail d’intervenants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de l’environnement, de manière à régler les problèmes de mise en oeuvre et à englober les trois piliers du développement durable – l’environnement, l’économie et la société. |
Engagements et conséquences des recommandations
Tous les gouvernements devraient déterminer les modifications à apporter à leur cadre législatif respectif pour pouvoir y intégrer les outils présentés dans le présent document et ainsi faciliter l’harmonisation de l’évaluation environnementale partout au Canada.
Les recommandations seront soumises à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et au ministre fédéral de l’Environnement pour que ceux-ci en tiennent compte dans le prochain examen de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.